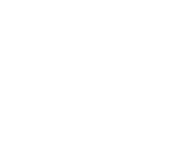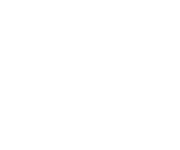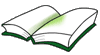|
Résumé :
|
Ce volume s'intéresse à l'ensemble des travaux menés en archéologie et à l'historiographie des limites géogra-phiques du Maroc oriental, de l'Antique à nos jours; après une analyse des sources grecques et latines, il explore systématiquement les travaux postérieurs. L'étude révèle non seulement les difficultés pour en cerner les limites, mais elle démontre que cette histoire ne peut être dissociée de la géographie. En effet, la situation de cette région, les distances, le climat, l'hydrographie ont joué un rôle considérable. Ils ont pesé lourd dans son évolution historique. Depuis la période antique, les limites géographiques des confins orientaux du territoire des Maurusioi / Mauri et de la Maurétanie Tingitane restaient difficiles à cerner. Celles que nous avons pu tracer à partir des sources grecques et latines (Polybe, Tite-Live, Strabon, Salluste, Pomponius Mela, Pline l'Ancien, Ptolémée) ne sont pas claires et révèlent la difficulté à définir les contours de cette région. À l'époque romaine, le ficuve Moulouya-la Mulucha, Molo-chath ou Malva des auteurs grecs et latins, la Malwiyya, Muluia des auteurs médiévaux - est devenu la frontière entre les deux provinces de Maurétanie, la Tingitane et la Césarienne. Cette situation n'a pas subi de changements notables après le départ des Romains et durant la conquête arabe au VIIe siècle, qui marqua le début de l'islamisation de la région. Comme beaucoup de provinces frontalières, le Maroc oriental a été, de tous temps, une zone contestée, une marche perpétuellement disputée entre les deux puissances voisines à l'est et à l'ouest: à la fin du VIIIe siècle, entre les Idrissides et les Maghraoua de Tlemcen, du XIIIe au XVe siècle, entre le royaume de Fès et les maîtres de Tlem-cen. Du XVIe au XIXe siècle, la région est devenue le théâtre de maints revirements dans les luttes opposant les Turcs d'Alger aux sultans marocains. Après la bataille d'Isly en 1844, la France héritière des Turcs en Algérie a imposé les limites actuelles, parfois imprécises, par le traité de Maghnia en 1845. Ce volume, à la fois bilan des connaissances et synthèse, souhaite remédier à cette lacune et combler un véritable vide sur l'histoire et l'archéologie du Maroc oriental. Il intéressera autant les archéologues et historiens qui travaillent sur l'Oriental marocain que tous ceux qui étudient d'autres régions. Il apporte ainsi une vision nouvelle sur bien des aspects et permet aux lecteurs curieux et à la communauté des chercheurs d'en prendre aisément connaissance.
|